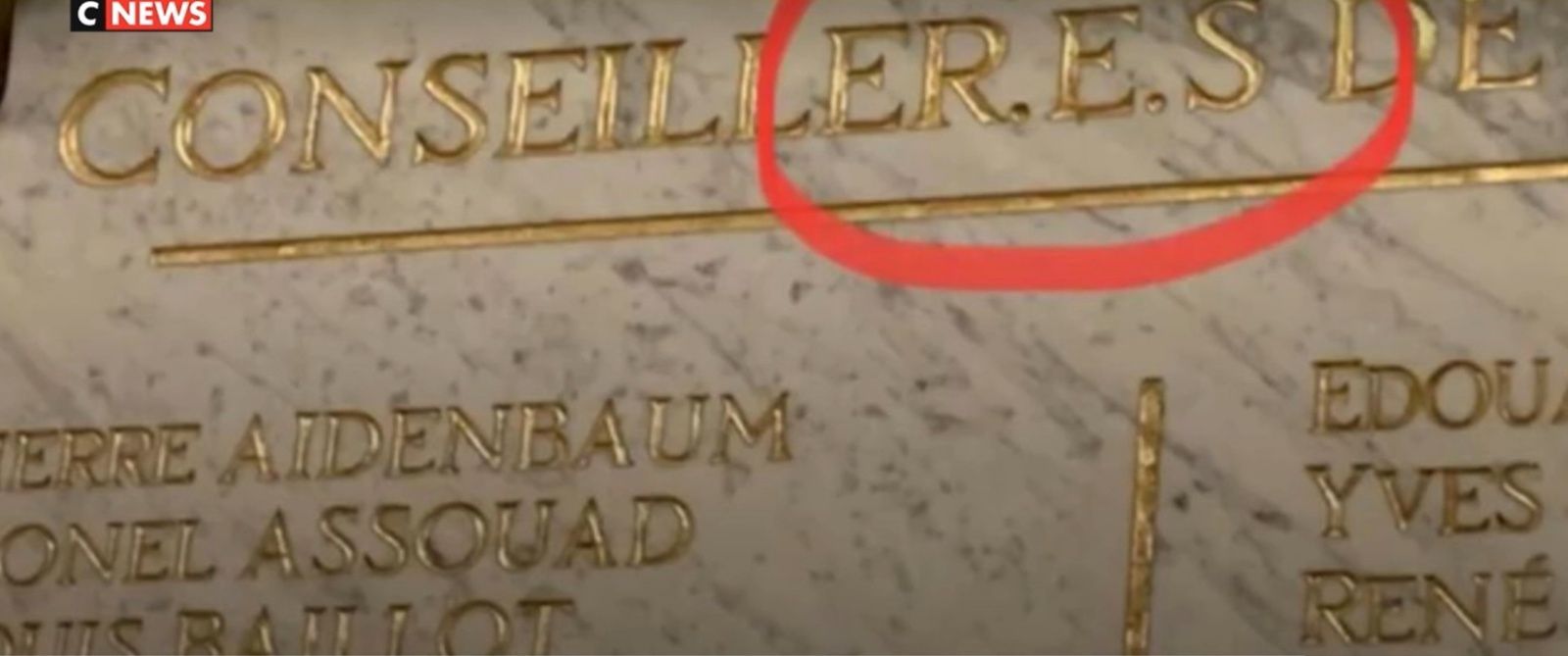Le mur et les enfants ou le bal des faux-culs
Du poids des idéologies, des appartenances partisanes, de l’information et de l’indignation sélectives

Les médias français, et bien au-delà, comme ceux de la bien-pensance étatsunienne, poussent aujourd’hui des cris d’orfraie devant des faits (enfants d’immigrants illégaux séparés de leurs parents) et des discours (affirmations provocatrices de Trump se disant décidé à appliquer la loi américaine tant qu’elle n’aura pas été légalement modifiée). Il en est de même du fameux mur séparant États-Unis et Mexique que l’on dit à tort « mur de Trump ». Si l’émotion est légitime, les mémoires sont bien courtes et il y a, dans la criminalisation des faits, comme toujours, deux poids deux mesures. Ce qui est acceptable (ou passé sous silence) à gauche (ou chez les démocrates aux Etats-Unis) devient criminalisable et « facho » à droite (ou chez les républicains).
Rappelons d’abord les faits.
1. Le mur tout d’abord .
L’opinion s’est d’abord focalisée sur la promesse de campagne du président américain de finir ce fameux mur, puis sur le décret du 25 janvier 2017 visant à démarrer les travaux. L’Europe sans frontières, échaudée par le mur de Berlin de sinistre mémoire, réagit naturellement par l’émotion et par analogie sans tenir compte des différences de contexte, à tout projet de construction d’une nouvelle matérialisation de frontière entre deux pays. Mais les mémoires sont bien sélectives. On entend ainsi parler (incompétence ou désinformation volontaire ?) de « construction » là où il ne s’agit donc que de prolongement et d’élargissement
Les objectifs sont clairs : la frontière américano-mexicaine, de l’Océan Atlantique au Pacifique, marquée sur une partie de son parcours par le fleuve Rio Grande (Rio Bravo del Norte) est longue d’environ 3200 km. Elle est la frontière la plus franchie au monde compte tenu de l’écart de développement économique entre Amérique du Nord d’un côté, et Mexique, Amériques centrale et du Sud de l’autre. Pour les États-Unis, un objectif déjà ancien a donc été de lutter conjointement contre les migrations économiques clandestines mais également d’empêcher commerce et passage des narcotrafiquants sur le territoire américain. En outre, ce qui se passe de l’autre côté de la frontière, où patrouille l’armée mexicaine, n’incite guère les Américains à ouvrir grand leur territoire aux migrants illégaux venant du Sud : la violence de la région est endémique et Ciudad Juarez en est l’exemple le plus révélateur. Ville la plus dangereuse au monde, elle présente l’effrayant bilan de 130 meurtres pour 100 000 habitants annuellement, liés entre autres à des règlements de comptes entre les commandos des Cartels mais aussi à un féminicide gratuit, par simple sexisme (plus de 2000 femmes assassinées entre 2000 et 2009), que dénoncent depuis longtemps les organisations humanitaires et les féministes d’Amérique du Nord.
L’historique du mur rappelle que tout cela ne n’est donc pas né avec le président Trump. La sécurisation de cette frontière a été une préoccupation constante de toutes les administrations successives depuis la fin des années 1970, qu’elles soient démocrates ou républicaines. Sous les présidences Carter, Reagan et G.H. Bush, cela s’est traduit par l’augmentation spectaculaire des financements pour le recrutement d’une force paramilitaire (la Patrouille frontalière), le déploiement de capteurs enterrés, d’hélicoptères, de spots lumineux et la construction d’une première barrière basse (notamment en zone urbaine) d’abord en chaîne puis en tôles. Sous les deux mandats de Bill Clinton ce furent des « opérations blocus » par le déploiement de gardes puis la mise en place de barrières un peu plus élaborées et solides que les premières.
Avec G.W.Bush et Obama, la « virtualisation » s’est ajoutée à la construction de barrières physiques : il s’agissait d’utiliser différentes technologies de surveillance (caméras high tech notamment, drones…) pour faciliter les interventions des gardes frontaliers. Parallèlement s’est poursuivie, modernisée et accélérée la construction d’« infrastructures tactiques » (nouvelles barrières et routes de patrouille), dont le fameux « mur » qui n’est donc pas « de Trump ». Par conséquent ce mur n’est qu’un élément, qui matérialise physiquement la frontière, parmi tout un dispositif de sécurisation et de militarisation de celle-ci.
Ce mur (18m de haut, miradors…) longeant le Rio Grande a ainsi été décidé et commencé par Bush en 2006 ( Secure Fence Act ), il s’agissait de prolonger le contrôle de la frontière, déjà effectif en zone urbaine, vers les espaces ruraux. En 2006, le Congrès Américain avait adopté le projet par 283 voix pour contre 138 contre (219 républicains et 64 démocrates avaient voté oui.) ainsi que le Sénat quelques jours plus tard (80 voix contre 19 parmi lesquelles 23 démocrates, dont Obama, contre 19 l’avait eux aussi approuvé).
Car le sénateur de l’Illinois, Barack Obama, avait bien voté pour le Secure Fence Act de 2006 et défendu la construction d’un mur matérialisant la frontière entre États-Unis et Mexique. Pour ce qui est de l’opinion publique, la décision fut rapidement plébiscitée (les migrations clandestines ayant rapidement diminué de 25%) : à l’époque du Secure Fence Act, 53% des Américains se disaient contre ce projet. En 2010, sous la présidence Obama, 68% s’y déclaraient favorables et 21% contre (ce qui a sans doute contribué à faire « oublier » sa promesse de campagne au président élu en 2009). Il en est de même de certains Etats qui aujourd’hui crient au scandale : en Californie la Garde nationale dès 2000 a déployé un important contingent pour soutenir l’action des garde-frontières fédéraux.
En effet, bien qu’ayant soutenu et voté pour la construction du mur en 2006, le candidat Obama lors de sa première campagne avait promis, pour satisfaire une partie de son électorat, de revenir sur le Secure Fence Act. Une fois au pouvoir il n’en a plus jamais reparlé et a laissé la construction se prolonger, restant sourd à toutes les voix qui s’élevaient pour lui rappeler sa promesse. Comme souvent, lors de l’accession aux responsabilités, ceux qui surfent sur les bons sentiments et sur l’émotion sont brutalement rappelés à la réalité des faits ! Ainsi les travaux de construction du mur, commencés sous l’administration Bush (455 km) et se sont prolongés sous l’administration Obama . À l’origine le mur devait être terminé en 18 mois, soit en 2008, mais le financement prévu a été multiplié par presque quatre, aboutissant au ralentissement puis à l’arrêt des travaux.

À l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, 1/3 de la frontière, soit 1300 km, étaient déjà matérialisés par cette nouvelle barrière. Pour lui, il ne s’agit donc pas de construire un nouveau mur, comme cela est ânonné régulièrement sur les médias français, mais de prolonger et d’élargir celui qui existe déjà. Mais Donald Trump se heurte, comme ses prédécesseurs, aux lourdes réalités financières. Le Mexique refusant de co-financer la construction, il est prévu de taxer de 20% les produits mexicains pour payer le prolongement de l’ouvrage. Mais Trump compte bien obtenir d’autres financements, d’où la poursuite de l’immigration clandestine au pénal et sa conséquence, la séparation entre adultes et enfants qui émeut aujourd’hui dans le monde entier.
Précisons enfin que le mur n’empêche pas les migrations légales et même illégales. Aujourd’hui on recense 3 millions de mouvements par an concernant les seules migrations (sans compter les 80 millions de touristes) et plus d’un million de passages autorisés quotidiens entre les deux pays pour des raisons, diverses (en grande partie touristiques et de travail) dont 200 000 personnes par jour à Tijuana, un record mondial ! Alors que seuls 5000 visas sont accordés aux travailleurs passant par cette frontière, ils sont 500 000 (dont 75% de Mexicains) estimés sur le marché du travail américain. L’immigration illégale reste donc élevée à la frontière avec le Mexique : de mars à mai 2018, plus de 50.000 personnes ont été appréhendées chaque mois. Environ 15% de ces clandestins arrivent en famille et 8% sont des mineurs non-accompagnés. On en arrive donc à l’affaire qui excite les médias et les consciences, jusqu’aux prises de position de l’ONU et de Mélania Trump.
2. La séparation entre parents et enfants pour les migrations clandestines
Les faits :
Le gouvernement Trump a annoncé récemment une politique de « tolérance zéro » en matière d’immigration et révélé que 1995 enfants avaient été séparés de leurs parents en 6 semaines, entre mi-avril et fin mai, soit presque autant que depuis son élection en octobre 2016. L’objectif, en médiatisant cette mesure et l’image des enfants parfois en pleurs et parqués derrière des grilles, est évidemment de faire réagir : d’un côté c’est évidemment un avertissement destiné à décourager les immigrants potentiels, de l’autre une façon de faire pression sur le Mexique qui refuse toujours de financer le mur tout en condamnant officiellement les filières d’immigration illégale, et enfin une volonté de mettre les démocrates et les républicains récalcitrants face à leur conscience pour obtenir du Congrès les milliards qui manquent au prolongement du mur.
Que dit la loi américaine ?
" Nous ne voulons pas séparer les familles, mais nous ne voulons pas que des familles viennent illégalement à la frontière […]. Si vous faites passer un enfant, nous vous poursuivrons. Et cet enfant sera séparé de vous, comme requis par la loi " a déclaré le Président américain. Car cette loi (Immigration and Nationality Act), datée de 1952, révisée en 1965 et durcie après le 11 septembre 2001, précise que, lorsque des adultes sont détenus dans le système pénitentiaire pour des délits pénaux, leurs enfants ne peuvent pas les suivre en prison : ils sont donc confiés à l'Office de relocalisation des réfugiés (ORR), qui dépend du ministère de la Santé et des services sociaux.
Qu’ont fait les démocrates ?
Ils ont évidemment appliqué cette loi chaque fois qu’un immigrant clandestin était poursuivi au pénal, arrêté et conduit en prison. D’ailleurs on peut entendre ici clairement Hillary Clinton, secrétaire d’Etat et le Président Obama rappeler cette loi et menacer les immigrants clandestins de ce qui les attend potentiellement. Mais le changement est que l’administration Trump inculpe plus facilement et plus souvent que ses prédécesseurs qui privilégiaient les poursuites au civil à l’encontre des clandestins passibles d’expulsion. Les familles étaient alors plus fréquemment détenues dans des centres de rétention administrative, ou leur cas traité par des voies alternatives, en attendant l’examen de leur demande d’asile.
Que fait l’administration Trump de plus ?
La « tolérance zéro » signifie que toutes les personnes interpellées en situation irrégulière sur le territoire américain n e sont plus poursuivies pour une infraction civile mais pénalement , donc appréhendées à leur entrée sur le territoire américain, incarcérées dans des prisons fédérales et leurs enfants (sauf les nourrissons) envoyés dans des centres de rétention séparés comme le veut la loi américaine. La criminalisation de l’immigration clandestine va de pair avec l’affirmation par le président américain que la hausse de la criminalité en Europe et les heurts interculturels assez violents sont la conséquence des migrations massives que celle-ci connaît principalement depuis 2015.
Quelques remarques en guise de conclusion
Il y a vraiment deux poids deux mesures dans la façon de présenter les informations. Si la construction de ce mur est une abomination ou si elle est légitime, elle l’était aussi du temps de ceux qui ont décidé de sa mise en place et ont autorisé l’édification des premiers 1300 km. Mais il semble qu’il y ait des discours ou décisions qui, sous la gauche en Europe ou les démocrates aux Etats-Unis soient parfaitement acceptables mais qui deviennent criminels, voire «fachos» dès lors que ce sont la droite ou les républicains qui sont concernés.
Si l’on considère que les Américains peuvent avoir des inquiétudes légitimes pour différentes raisons face aux migrations massives, cela vaut évidemment autant pour les périodes Clinton, Bush, Obama ou Trump. Rappelons que ces inquiétudes ont pu concerner l’emploi en période de chômage, aujourd’hui largement jugulé, et la volonté manifestée par les électeurs américains que toutes les ressources nationales soient désormais destinées prioritairement aux nationaux. Puis il y eut le renforcement de l’enjeu sécuritaire après le 11 septembre 2001, que cela concerne le terrorisme, la criminalité ordinaire ou les ravages de la drogue importée par les cartels et narco-trafiquants sud-américains.
Enfin, comme en Europe, se posent des questions identitaires : déjà en 2004 le professeur de Harvard Samuel Huntington s’interrogeait sur l’hispanic challenge . Représentant jusqu’à 60% des électeurs dans des portions de territoires, en particulier au Sud, les Hispaniques sont devenus la première minorité aux Etats-Unis, devant la minorité noire. De manière plus générale, les WASP (white anglo saxon protestants), les Blancs, seront minoritaires en 2042 , si les tendances se poursuivent, à la fois en raison de la poursuite de l’immigration mexicaine et d’une croissance naturelle plus soutenue. Huntington, s’appuyant sur le développement de la langue espagnole remplaçant de plus en plus l’anglais dans certains Etats, sur des revendications identitaires menant à l’éclatement communautariste et sur certaines enclaves, en particulier dans les Etats du Sud, regroupant des populations hispaniques vivant entre soi et refusant d’intégrer les codes de la civilisation américaine, craignait la partition prochaine du territoire américain en deux langues, deux civilisations alors que d’autres théoriciens, s’appuyant sur des revendications explicites d’activistes anti-américains et racistes, parlaient carrément d’invasion, de remplacement, de « revanche ». L’image du salad bowl (le bol de salade où les ingrédients sont juxtaposés) a remplacé dans les études sociologiques le légendaire melting pot , le creuset où toutes les influences se fondaient autrefois pour forger l’homme ou la femme américains.
Ceci dit, depuis la publication de cette étude qui a profondément marqué (et traumatisé) l’opinion américaine, on s’est aperçu (et Huntington lui-même l’a reconnu, revenant peu avant son décès en 2008 sur une partie de ses craintes) que tout n’était pas aussi simple, la fécondité d’immigrants hispaniques s’alignant progressivement sur celle des Américains plus longuement installés, la langue anglaise s’imposant chez les élites mexicaines intégrées. Le vote des « latinos» et des autres minorités qui, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ne fut pas défavorable à Trump malgré son discours anti-immigrationniste, est la preuve que, d’une certaine manière et dans une certaine mesure, l’intégration façon « melting pot » poursuit son cours et que de nombreux immigrés, une fois installés, craignent comme d’autres Américains, les vagues migratoires à venir et de voir leurs conditions de vie se dégrader. Par contre, les craintes exprimées au début du XXIe siècle d’une société éclatée par le communautarisme des minorités issues de l’immigration semble aujourd’hui largement vérifiées par l’essor de mouvements identitaires et des discours revanchards, racialistes, essentialistes et souvent racistes (anti-blancs) nord-américains, plus récemment importés en Europe (Racisé.e.s, Indigènes de la République …). La situation est donc complexe et irréductible à des slogans politiques, qu’ils soient immigrationnistes, nationalistes ou carrément xénophobes.
Le parallèle avec les inquiétudes qui montent en Europe jusqu’à bouleverser le jeu électoral et l’équilibre des forces dans de nombreux pays, est évident. Que les partisans de frontières ouvertes et d’une immigration massive, qu’elle soit économique ou humanitaire, condamnent fermement la politique étatsunienne est parfaitement cohérent et normal. Il est juste étrange qu’ils fassent semblant de penser que tout a commencé avec Trump, même s’il est vrai que le remuant président américain clame bien haut ce que ses prédécesseurs faisaient plus honteusement sans s’en vanter. Mais enfin, le mur de Bush fut longtemps un classique des sujets du bac en terminale et à l’Université, personne ou presque ne peut prétendre qu’il ignorait qui en avait décidé la construction et qui l’avait poursuivie ! Mais en revanche il est curieux de voir certains faiseurs d’opinion, journalistes ou politiques, et de nombreux internautes, alors qu’ils reconnaissent souhaiter instamment le retour de la fermeté sur les frontières de l’Europe et que l’on puisse à nouveau distinguer les véritables demandes d’asile de la migration économique, voire de motivations nettement plus floues, s’interroger sur la légitimité des inquiétudes américaines et s’indigner de la volonté affichée de son administration de mieux contrôler les frontières de l’Etat fédéral.
Certes l’application de la loi est cruelle. La question est de savoir et de décider, une bonne fois pour toutes, si l’on peut ainsi jouer sur l’émotion (même si les enfants ne sont pas maltraités, la séparation d’avec les parents est cruelle et peut laisser des traces ultérieurement) pour faire pression et se faire entendre. Car, en retour, on joue également sur l’émotion, que ce soit pour trouver le prétexte à des ingérences extérieures dans des pays souverains ou pour faire entrer des populations illégalement sur le territoire européen. Les ONG dans leur collaboration objective avec les passeurs généralement islamistes en usent en permanence. Si cette « démocratie de l’émotion » est effectivement abjecte, il faut reconnaître qu’elle l’est dans tous les sens quand il s’agit de manipuler les opinions au détriment du droit, des faits et de la volonté ou de l’intérêt des peuples concernés.
Les Etats qui dénoncent aujourd’hui cette forme de chantage au sentiment de l’administration Trump ne sont pourtant pas les derniers à s’en servir. L’Aquarius, en quelque sorte pris en otage et bloqué une semaine durant sur la Méditerranée, dans le refus explicite des uns et le silence assourdissant des autres, est l’équivalent de l’isolement des enfants sur la frontière entre Mexique et Etats-Unis : c’est un moyen de se faire enfin entendre pour les Etats qui souhaitent une prise de conscience et un changement de la politique migratoire européenne. Certains envisagent même désormais la solution la plus logique, qui serait de ramener les navires de clandestins vers les ports les plus proches, en Tunisie ou en Libye, ce qui serait une bien cruelle fin de traversée pour ces candidats à l’immigration dont on apprend que chacun a payé 3000 euros aux passeurs (manne financière continue qui va alimenter le djihad et le trafic d’armes) ! Mais ce serait assurément une solution radicale pour mettre un terme au petit jeu entre filières crapuleuses de passeurs et ONG patrouillant en permanence aux larges de leurs eaux territoriales, créant cet appel d’air continu et rendant de facto caduc l’accord avec les autorités libyennes visant à examiner sur place les demandes d’immigration. Mettre un terme au trafic éviterait à ces populations en détresse politique ou économique un déplacement coûteux, risqué, parfois vain quand il se solde par un retour après rejet de la demande d’asile, ou des conditions de vie indignes et très loin de leurs attentes lorsqu’ils arrivent et restent sur des territoires qui n’ont plus les moyens de les accueillir, donc de les intégrer. Avec les conséquences que l’on connaît … Faudra-t-il en arriver comme Trump au chantage à la cruauté pour que l’on pose enfin collectivement, sans anathème ni procès d’intention, les problèmes liés à l’immigration sur la table, dans l’intérêt de tous, et des pays d’accueil, et des immigrants en transit, et des pays de départ pour lesquels la bien-pensance ne se pose jamais la question des effets de la privation, pour ces Etats, de milliers d’hommes, plus rarement de femmes, jeunes et dynamiques. Ils sont pourtant l’avenir du continent africain, et constitueraient déjà une force vive pour les armées africaines que doivent suppléer des militaires français qui, parfois, tombent sur le sol étranger. Les sociologues, économistes et démographes ont pourtant, depuis longtemps alerté sur les effets à moyen et long terme de cette “géographie de l’absence”!
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ? Il est en tous cas étrange de lire ou d’entendre ainsi condamner par certains ce qui se fait aux Etats-Unis tout en manifestant les mêmes inquiétudes et la même volonté de renforcement de contrôle ici, pour de simples raisons d’appartenance idéologique ou par répulsion pavlovienne pour celui que les médias ont choisi de diaboliser. Cela ne dit pas qu’il ait raison ou tort, la réalité hélas n’est pas manichéenne mais d’une complexité rare, puisque se mêlent dans ces questions-là les lois des Etats et les droits de l’homme, les émotions brutes et les faits constatés, les intentions et les arrière-pensées, les risques et les avantages, les responsabilités des uns et des autres, d’hier, d’aujourd’hui et de demain …. S’il y avait une solution évidente en matière de migrations, elle aurait été appliquée depuis longtemps.
Mais si l’on continue de se positionner non pas en fonction des faits et des discours, avec lesquels on est d’accord ou pas, mais en fonction de qui les tient et de ce que les médias nous autorisent à penser, et cela vaut pour la question migratoire comme pour toutes les autres priorités , nous serons condamnés à subir éternellement ce que d’autres auront décidé à notre place. Il y a des moments dans l’histoire des nations où, lorsque l’on a sérié les priorités et l’urgence, l’union est nécessaire au-delà des divergences, car elle seule fait la force. Se positionner en fonction de chapelles, de sympathies ou d’antipathies, de concurrences entre mouvements ou entre leaders d’opinion, est le meilleur moyen d’offrir la victoire à nos adversaires, voire à nos ennemis.