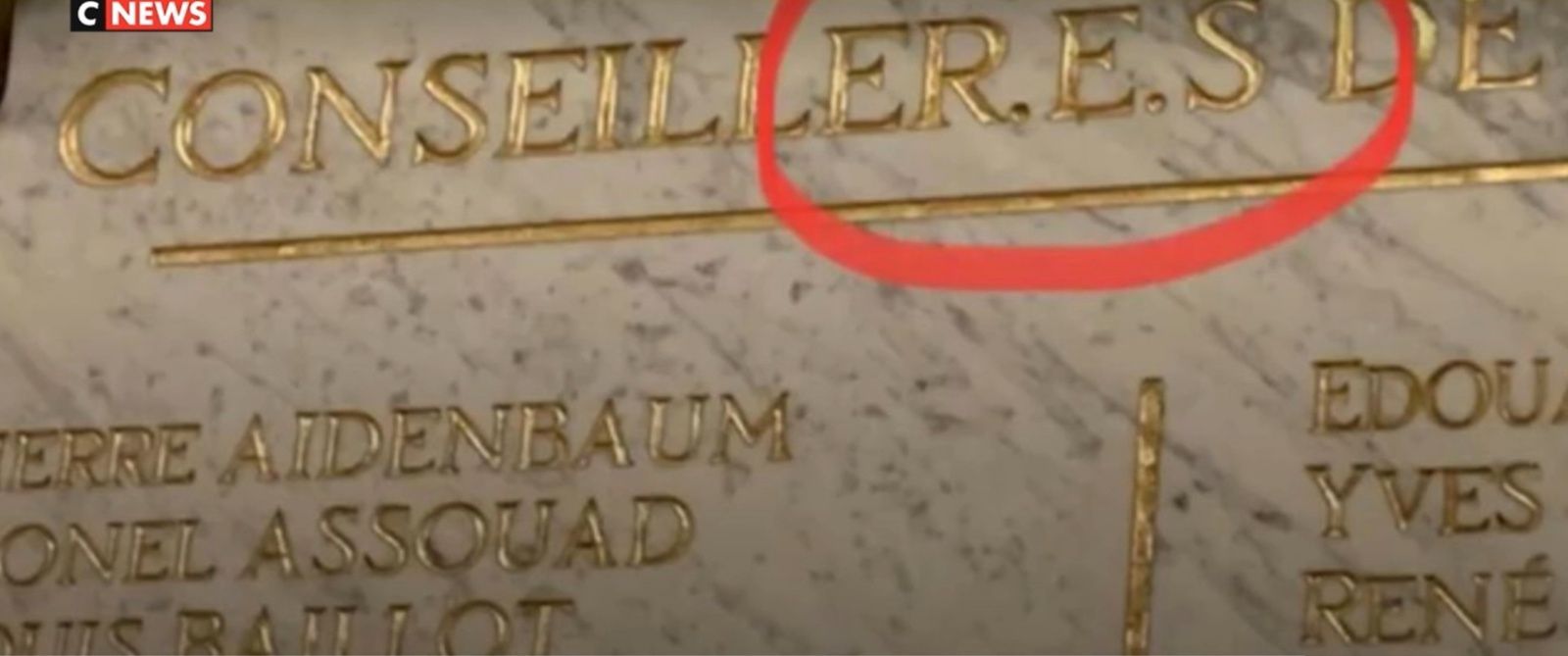Je suis de droite parce que....
Ceci est le sous-titre de votre nouveau post

2. J’ai choisi la liberté
Il s’agit ici du second volet de la série “ Je suis de droite parce que …” destiné à dépasser les postures et les gesticulations rhétoriques et à réfléchir ce qui fonde notre engagement politique, le mien en l’occurrence aujourd’hui “plutôt à droite”, et nous fait apporter notre soutien à tel ou tel mouvement, varier éventuellement dans nos préférences, donc dans nos votes, au-delà des appartenances quasi pavloviennes qui nous font affirmer péremptoirement que l’on est de droite ou de gauche parce que “cela a toujours été comme ça”. Dans le brouillard des idées ambiant (expression qui date déjà des années 1980), où pour certains gauche et droite se confondent, il devient urgent pour chaque “camp” de redéfinir concrètement les valeurs qu’il défend. Aujourd’hui tout le monde est pour la liberté, la fraternité, l’égalité des droits, le social ... Oui mais dans les faits, ces priorités sont-elles toujours compatibles? S’il faut privilégier l’une ou l’autre composante de notre devise républicaine, laquelle choisit-on? Et pourquoi? Qu’est-ce qui nous différencie des autres dans la défense de telle ou telle valeur? Parle-t-on vraiment de la même chose derrière les mêmes mots?
Le premier volet ( https://www.facebook.com/notes/nj-gray/je-suis-de-droite-parce-que-/10218334859555945/ ) s’attachait à expliquer pourquoi je n’étais plus de gauche: n’ayant pas évolué sur mes valeurs fondamentales, les faits m’ont démontré que ces dernières n’étaient plus défendues par la gauche à laquelle j’ai cru appartenir mais par une (partie de la) droite devenue un peu plus audible parce que moins complexée par les procès d’intention et caricatures dressés par ses adversaires. Même si le chemin reste long à parcourir. Aujourd’hui nous nous attachons à la valeur “liberté”. Apparemment défendue par tous, la “vraie liberté” , réelle et concrète, est restée une valeur de droite.
*
« Oui, évidemment, me dira-t-on à droite, tu enfonces des portes ouvertes ». Et de fait la droite est souvent associée à la défense des libertés (libertés individuelles, libéralisme, école dite libre qui permet la liberté de choix et la différenciation…). Jusque dans les cours de sciences politiques, la liberté est présentée comme une valeur de droite, alors que l’égalité serait la référence forte de la gauche. C’est d’ailleurs ainsi depuis longtemps que les politologues différencient les deux grandes forces d’une France longtemps bipolarisée. Lorsqu’il faut choisir ou privilégier l’une au détriment de l’autre, la droite choisirait toujours la liberté, la gauche l’égalité. Ce n’est pas faux, comme nous le verrons, mais il va falloir creuser davantage ces définitions, car elles sont polysémiques.
« N’importe quoi », me rétorquera-t-on à gauche, la défense des libertés est l’un de nos combats principaux, notamment contre les actions et projets de la « droite liberticide ». Et il est indéniable que ce combat est également le mot d’ordre d’organisations de gauche et d’extrême-gauche qui appellent souvent à manifester contre les « atteintes aux libertés » (état d’urgence, déchéance de nationalité, loi Collomb encadrant l’immigration, actions des forces de l’ordre, interdiction de manifester en certains lieux, contrôles préventifs …), mises en place par des gouvernements qui attenteraient à la liberté de manifester, de se déplacer et de s’installer où l’on souhaite, voire même de s’attaquer aux biens d’autrui pour de bonnes raisons il s’agit d’un ennemi de classe, d’un traître ou d’un symbole…
Le fait est que tout le monde se réclame de la devise républicaine et de ses trois composantes. Il n’y a pas une idéologie qui ne se prononce pas en faveur de la liberté . À partir du moment où l’on constate cet état de fait, que l’une des valeurs souvent attribuée à la droite est partagée par tout le monde, que fait-on ? Se contente-t-on de continuer dans la posture, les discours et le mot d’ordre, pour ne pas dire les échanges de cours de récréation (– c’est moi qui défends le mieux la liberté. – Non c’est moi ! – Moi plus que toi ! – Non c’est moi qui l’ai choisie en premier, et c’est le premier qui l’a dit qui l’est) ? Ce genre de postulat, qui tient du prêt-à-penser ne peut que séduire les militants et électeurs déjà convaincus. Mais ce n’est pas avec des gesticulations que l’on peut espérer séduire les autres et déjà faire revenir ceux qui, déçus, sont partis. De deux choses l’une : si tout le monde est d’accord, il devient inutile de brandir un concept comme élément constitutif de son combat et, si ce dernier est menacé, il s’agit de s’allier, toutes tendances convaincues, pour en défendre le principe et permettre sa réalisation. Mais si l’on perçoit qu’il existe une différenciation, un malentendu lié à une interprétation différente du même mot, il faut expliquer clairement ce qui sépare les deux « camps », de sorte que chacun se positionne en fonction de ses valeurs et aspirations .
C’est ce que nous proposons d’esquisser ici. Nous verrons d’abord que la droite et la gauche ne sont pas attachées aux mêmes formes de liberté et n’en ont pas la même définition (A), qu’entre liberté et égalité elles n’ont pas la même hiérarchie de priorités (B), que la conception de la liberté selon la gauche peut s’avérer liberticide, contreproductive, conduire à la médiocratie quand celle de la droite libère l’individu, l’économie et reste le meilleur soutien de la démocratie représentative (C).
A. La droite défend une forme de liberté et la gauche une autre.
La première explication de cette apparente parenté de combat, c’est que la droite et la gauche ne défendent pas la même liberté. Il y a en effet en philosophie politique [1] deux conceptions de la liberté : la liberté négative (la seule liberté réelle ), qui est l’absence d’entraves pour faire quelque chose, en d’autres termes la liberté de ; et la liberté positive, la possibilité de faire quelque chose, la capacité de . Précisons au passage qu’il n’y a aucun jugement de valeur dans les termes « négatif » ou « positif ». Toutefois, la connotation du mot « négatif » explique qu’en politique, on utilise moins ce terme que des périphrases pour exprimer son contenu. Je le reprends donc ici sur le plan philosophique mais il est évident qu’il serait contre-productif sur le plan médiatique : qui oserait sembler se prononcer contre la liberté ?
La droite illustre la défense et le combat pour les libertés réelles, dites négatives.
Ce que les philosophes nomment liberté négative correspond en effet aux libertés réelles , c’est-à-dire la possibilité et le droit pour chacun de posséder un espace privé, inviolable donc sûr, dans lequel il puisse penser et s’exprimer librement (liberté de pensée et d’expression), posséder (droit de propriété), se déplacer (liberté de mouvement), croire (liberté de conscience) et choisir (liberté de choix) sans qu'aucun pouvoir extérieur ne puisse intervenir pour l’en empêcher, tant qu’évidemment ces activités personnelles ne contreviennent pas aux lois en vigueur (que l’on peut néanmoins s’efforcer de changer, par le débat démocratique, si on les juge trop liberticides). Ce « pouvoir extérieur » qui limite la volonté autonome d’un individu peut être, et de plus en plus aujourd’hui, la chape morale que l’on qualifie souvent de « gauchisme culturel » qui, par l’appel à la censure, la stigmatisation, l’insulte, le procès d’intention, la criminalisation de toute pensée divergente, voire la violence de rue, conduit à s’autocensurer et craindre le jugement, voire la réaction d’autrui.
Cette conception de la liberté bien évidemment s’entend dans l’acception que lui donnaient les philosophes des Lumières, c’est-à-dire qu’il ne s’agit évidemment pas d’une liberté sans aucune entrave , façon anarchisme, elle s’arrête là où commence la liberté d’autrui, ce qui revient à dire que l’on ne peut pas tout se permettre si cela doit nuire à son voisin ou à la société ou si cela doit perturber l’ordre public. Cette limitation des libertés devrait se faire naturellement par le bon sens et l’esprit civique des individus, qu’ils soient innés ou transmis par l’éducation nationale et parentale. À défaut, et c’est malheureusement de plus en plus le cas aujourd’hui en raison de la faillite des transmetteurs précédemment cités, c’est à l’État de garantir les droits et libertés de chacun et l’ordre social, y compris en dernier recours par ce dont il est le seul dépositaire, la « violence légitime » (Max Weber) par l’intermédiaire des forces chargées de garantir cet ordre et la sécurité de chacun. Violence, rappelons-le, qui n’est que la réaction légale à des actes illégaux. On voit ici que la sécurité n’est nullement antinomique du principe de liberté , comme le prétend une partie de la gauche. Bien au contraire, elle la garantit.
En concordance avec cette conception de la liberté, la droite défend donc les libertés civiles et politiques de pensée, d’expression, d’association, de résidence, de culte, de propriété, (d’acquérir, de transférer, de transmettre la propriété, d’en jouir librement), d’entreprise (créer, diriger, fusionner, diviser, mettre en faillite, réajuster ses effectifs, vendre, transmettre)… À noter que l’on peut remplacer le mot liberté, dans les exemples ci-dessus, par « le droit de », les deux termes étant inextricablement liés en philosophie politique, le droit étant une liberté encadrée dans le cadre du contrat social, et non une liberté absolue, effrénée et potentiellement liberticide pour autrui. Il s’agit de vivre et de pouvoir gagner sa vie sans entraves trop handicapantes de la part de l’État ou des institutions (noter la préposition négative). Ces libertés réelles, défendues par la droite, relèvent donc avant tout de l’économique et du social .
Ces valeurs sont-elles aussi de gauche ? Pour certaines, on verra qu’elles le sont dans les discours mais qu’elles ne peuvent l’être, du moins totalement, dans les faits car elles entrent en contradiction avec la priorité de la gauche qui est l’égalité, voir l’égalitarisme. Pour d’autres, elles lui sont totalement étrangères (sauf pour cette partie de la gauche convertie au libéralisme que les gens qui se disent de la « vraie » gauche accusent d’avoir trahi ). Ainsi la liberté de propriété et la liberté d’entreprise sont-elles deux valeurs essentielles de la droite auxquelles la gauche a continuellement fait obstacle : nationalisations, impôt progressif, réglementation du travail, contrôles permanents et tatillons (souvent prétextes, dont l’impact sur l’environnement, nécessaires mais souvent utilisés pour freiner l’investissement), interdictions de travailler davantage, alourdissement des droits de transmission des patrimoines, aujourd’hui IFI (mis en place par un gouvernement où la majeure partie des ministres sont à gauche)… Sans compter les caricatures manichéennes de l’entreprise, véhiculées par les discours et l’enseignement (surtout en sections économiques) présentant l’entreprise façon Germinal, patrons cruels et égoïstes, capitalistes obèses, ouvriers écrasés, salariés faméliques … Le patron (un gros mot !), qu’il soit celui d’une grande entreprise du CAC 40 ou le petit artisan dirigeant une équipe de trois ouvriers, est nécessairement un salaud, un profiteur et un « rentier » qui ne bosse pas et fait travailler les autres.
Aujourd’hui l’image de l’entreprise change, il faut reconnaître au gouvernement actuel de se battre à cet égard pour la réhabiliter, mais la description ci-dessus n’apparaissait même pas comme caricaturale, dans une France acquise au gauchisme culturel, il y a encore une dizaine d’années. Et la gauche continue de reprocher au libéralisme économique de créer des besoins qui n’existent pas. Il y a une part de vérité dans ce constat mais est-ce pour autant qu’il faudrait empêcher d’entreprendre et de vendre ? Il n’en reste pas moins que les principaux besoins auxquels l’économie libérale répond sont des besoins de base (se nourrir, se loger, se déplacer, s’instruire, se divertir …) et que la mondialisation a permis depuis quelques décennies, dans l’absolu, une augmentation spectaculaire du niveau de vie et une diminution de la pauvreté sensible à l’échelle de la planète. Ce qui ne veut pas dire que les inégalités n’ont pas augmenté et que la mondialisation aujourd’hui n’a pas besoin d’être révisée et repensée, ne serait-ce que pour des questions environnementales.
À gauche on défend également la liberté, mais ce n’est pas la même.
La gauche identifie en effet la liberté à l'égalité matérielle . C’est la conception de la liberté positive, c’est-à-dire la capacité de, la possibilité de… Pour la gauche peu importe les droits et libertés ci-dessus mentionnés : si l’on n’a pas les moyens de s’acheter une voiture, on ne bénéficie pas de la liberté de se déplacer à volonté. Si l’on a trop petit salaire ou que l’on n’a pas d’emploi, la liberté de propriété ne nous intéresse pas. Si l’on n’a pas les moyens de se soigner, on ne se soigne pas. La gauche reproche à la droite de promouvoir des libertés spécifiques garanties par un système légal mais ne pas donner à tous les moyens de s’en servir. Elle va promouvoir non pas le droit ou la liberté, qui sont acquis, mais la possibilité pour tout le monde d’accéder à la même chose. Et comme elle n’a pas une baguette magique pour donner à ceux qui n’ont pas la même chose que ceux qui ont, elle va piocher dans les poches des uns pour donner à d’autres, redistribuer, égaliser, limiter les libertés négatives au nom d’un chemin hypothétique vers des libertés positives.
Et c’est là où droite et gauche diffèrent. À partir de ce constat, qui est indéniable (tout le monde n’a pas la possibilité de), la gauche va donc limiter la liberté de ceux qui gagnent plus que d’autres de jouir librement de leur argent, les empêcher de s’enrichir davantage, en particulier par un impôt redistributif prétendant réduire les inégalités et en donnant aux plus démunis, ou plus exactement à ceux qu’elle considère (sincèrement ou par électoralisme) comme plus démunis. Que ces défavorisés, par le biais de transferts sociaux défiscalisés et d’aides diverses aient autant ou même davantage qu’une grande partie de ceux qui gagnent peu, et que cela ne pousse pas à travailler dur, ou à travailler tout simplement, est une autre question que nous n’aborderons pas aujourd’hui, celle du dérèglement de l’État-providence tombé dans un système d’assistanat décourageant le travail, et générateur d’importants flux migratoires vers une France généreuse au-dessus de ses moyens.
La gauche aujourd’hui est ainsi passée de la légitime et partagée par tous revendication de l’égalité des droits vers un égalitarisme nivelant et homogénéisant la société française sur le plus petit dénominateur commun. Puisqu’on ne peut tirer tout le monde vers le haut, limitons les droits et les libertés de ceux qui se détachent et dont la tête dépasse. Dans cette optique, l’État omnipotent et omniprésent joue un rôle essentiel. S’il limite par la loi et l’interventionnisme les possibilités (de posséder, de transmettre, d'entreprendre, de travailler au-delà des maxima légaux, de devenir riche…), il est certain que l’on réduira à termes, ce faisant, les inégalités. Mais en nivelant vers le bas. À droite au contraire, on considère que limiter droits et activités est contre-productif, on croit encore à l’ascenseur social et à l’exemplarité, aux réussites façon self made man à l’américaine, et l’on cherche à tirer le maximum de personnes vers le haut, ce qui n’exclut pas des mécanismes de correction et de redistribution , tant qu’ils n’handicapent pas trop les droits et libertés individuelles et ne deviennent pas contre-productifs en termes économiques. C’est une différence majeure.
Ajoutons enfin qu’à la gauche de la gauche, traditionnellement, on défendait également une autre conception de la liberté individuelle qui se manifeste, elle, par le droit de tout faire (au nom de l’idéal du camp du Bien), le rejet de toute autorité (professeurs, policiers, leaders …) et l’affirmation de la volonté de pouvoir vivre sa vie sans entraves ni de l’État, ni des institutions. Autrefois défendue par les seuls gauchistes, cette conception de la liberté absolue et sans entraves s’est aujourd’hui répandue dans l’ensemble de la gauche (et d’une partie de l’extrême droite), en particulier avec ce qu’est devenu à partir du mois de décembre le mouvement des « gilets jaunes », rejetant violemment et a priori la violence légitime de l’État, c’est-à-dire l’intervention légale contre des formes d’action illégales (violences urbaines…). La gauche légaliste est donc allée jusqu’à reprendre le slogan gauchiste des « violences policières », se donnant unilatéralement le droit d’attenter aux institutions, donc au contrat social, ce qui reste logique pour les courants révolutionnaires qui le rejettent, mais nettement plus ambigu et hypocrite pour ceux qui prétendent l’accepter et chercher à le réformer par la voie légale du débat et de l’élection. Cette seconde conception un peu particulière de la liberté sans entraves, c’est l’équivalent de ce que l’historienne Barbara Lefebvre a nommé pour les populations scolaires d’aujourd’hui la « génération j’ai le droit ». À noter que cette conception anarchiste ou gauchiste de la liberté, qui dans le cas présent se veut absolue (dans l’attente du chaos donc du Grand Soir à partir duquel on construira la société idéale, forcément égalitaire et homogène) entre en contradiction avec la conception de la gauche classique pour laquelle l’État interventionniste et redistributif est tout, possède tous les droits, notamment celui de prendre aux uns par les impôts ce que l’on redistribue aux autres, d’empêcher certains de faire pour permettre à d’autres de réaliser, ce qui a donné naissance, sous d’autres cieux … aux régimes parmi les plus totalitaires et liberticides qui soient.
Il s’agit donc de comprendre que la liberté négative défendue par la droite est une liberté réelle alors que la liberté positive de la gauche est virtuelle, intentionnelle, et indissociable de l’égalitarisme.
B. Quelle priorité entre liberté et égalité/égalitarisme ?
La droite et la gauche revendiquent le même objectif, le bien-être des populations tant sur le plan matériel que spirituel, pour tous sans exception. Mais elles diffèrent sur les moyens d’y parvenir. La gauche recherche la liberté à travers une priorité qui est l’égalité, la droite recherche la liberté, modérée par le principe d’égalité . Pour elle l’égalité doit introduire des corrections mais elles ne seront jamais que cela. L’égalité n’est pas l’objectif majeur, qui reste la liberté. Notons que l’on ne parle pas ici de l’égalité des droits, principe fondamental inscrit dans les droits de l’homme et du citoyen, sur laquelle évidemment tout le monde est d’accord et que nul ne discute, mais de la recherche de l’égalité réelle, c’est-à-dire l’uniformisation des niveaux et modes de vie, des croyances, des revenus, des patrimoines, ce que l’on nomme l’égalitarisme .
C’est avant tout sur la priorité accordée à l’un ou l’autre de ces deux principes inscrits dans notre trilogie républicaine que les politologues différencient droite et gauch e. La droite a élu la liberté négative (réelle) comme objectif moral primordial. Elle défend, comme tous, l’égalité des droits mais non l’égalité économique et sociale, par pragmatisme d’une part, droit à la différenciation individuelle de l’autre, qui est le fondement des libertés.
Pour la gauche au contraire, c’est l’égalité et son corolaire, l’uniformisation, qui est l’objectif ultime, elle part du principe qu’il faut réduire ou supprimer les inégalités entre les êtres humains ou entre les groupes sociaux, ce qui la conduit souvent à mettre des entraves croissantes au libertés réelles (dites négatives) défendues par la droite. Son combat est de donner à tous « la possibilité de » , donc d’œuvrer pour la liberté dite positive.
Or le réalisme, qui oblige au pragmatisme, nous enseigne qu’il faut souvent choisir le poids que l’on accorde à chacune des deux premières composantes de notre trilogie républicaine . Car la liberté et l'égalité ne sont pas toujours compatibles, et même rarement. Il est très souvent mensonger de prétendre défendre les deux en même temps, du moins en les plaçant sur le même plan. La permanence des inégalités, à l’échelle de la planète, est un constat : nous naissons libres et égaux en droit, mais pas tous dans le même contexte socio-économico-culturel (patrimoine, éducation, revenus, territoires), ni avec les mêmes potentialités (talent, santé, aptitude au travail et au risque, intelligence…). C’est exactement la même chose pour les territoires qui ne sont ni isotropes ni isomorphes : donc en clair, on peut brailler que l’on se bat pour « l’égalité des territoires », ce qui ne veut strictement rien dire, on ne fera jamais d'une montagne pentue, froide et à la mise en valeur difficile, un littoral plat, attrayant et favorable aux hommes et au commerce. Il est vain de réclamer « l’égalité territoriale » à grands cris, qu’il faut remplacer par la recherche de l’équité, ce qui est sensiblement différent. Sans compter que ce qui était répulsif autrefois (par exemple un littoral où l’ubac, le versant le moins ensoleillé d’une montagne, un sol crayeux comme en Champagne autrefois dite « pouilleuse ») devient, par l’évolution des systèmes économiques (maritimisation des économies, essor du tourisme montagnard et littoral, nouveaux intrants et mécanisation), aujourd’hui un atout. Jusqu’au prochain changement, quand des atouts deviennent des aménités, et d’anciens avantages des handicaps.
Si l’on cherche à corriger ces inégalités, il faut aller contre des tendances naturelles ou des réalités territoriales. Or aller contre revient souvent à contraindre. Donc lorsque l’on vise un monde plus égalitaire, nécessairement, on contraint, on empêche, on prend aux uns ce qui manque aux autres (ça peut aller jusqu’à l'impôt confiscatoire et la redistribution) au nom de la solidarité et l’on réduit les libertés (de gagner davantage, de créer, de profiter de ses richesses, de transmettre facilement…). Le principe est évidemment honorable et personne aujourd’hui, à commencer par les partis de droite, ne s’élève contre des mécanismes correctifs ou redistributifs, sauf quand ils tombent dans l'égalitarisme et la confiscation.
On dit la droite « conservatrice », ce qui signifie non pas qu’elle veut maintenir, coûte que coûte, des inégalités mais qu’elle ne fait pas de leur réduction une priorité en soi , si cela conduit à trop rogner sur les libertés précédemment citées, puisque la défense des libertés individuelles est, précisément, son objectif premier. Il ne s’agit pas d’être méchant ou gentil, généreux (avec l’argent des autres !) ou égoïste, comme on l’entend dire parfois dans des échanges politiques de café du commerce, c’est juste une question de mesure et de priorité. Les deux attitudes, privilégier la liberté ou faire passer en premier l’égalité, sont légitimes et dépendent des aspirations, de l’éducation ou de l’endoctrinement de chacun, il s’agit par contre d’être clair sur les objectifs, de ne pas défendre tout et son contraire en faisant semblant de croire que les deux sont compatibles, et de se positionner en connaissance de cause.
C. En ce qui me concerne, j’ai choisi la liberté réelle (dite négative), la « liberté de » .
Et cela pour plusieurs raisons.
D’une part parce que la défense des libertés positives (donc la recherche d’une égalité dans les possibilités) conduit souvent à des mesures liberticides.
Passons rapidement sur les exemples historiques qui montrent que là où la gauche a donné à l’État le droit de restreindre les libertés négatives pour donner à chacun la possibilité d’atteindre les libertés positives (cf. les grands totalitarismes du XXe siècle, URSS, Chine …), cela n’a nullement, au bout du compte, réduit les inégalités, l’appareil économique et les richesses restant aux mains d’une nomenklatura restreinte et le reste de la population, effectivement homogénéisé et aligné sur le minimum, s’étant collectivement appauvri, en proie à de grandes famines meurtrières récurrentes, privé au bout du compte à la fois des libertés négatives mais aussi des libertés positives. Sauf si l’on considère que d’avoir la possibilité d’accéder au strict minimum permettant à peine de reconstituer sa force de travail, le même pour tout le monde, est une véritable liberté.
La gauche effectivement, pour tenter de construire une société égalitaire (non en droits, elle l’est déjà, mais dans les faits) rogne sur les libertés économiques de « faire » : d’entreprendre librement, de transmettre facilement (la transmission augmentant les inégalités), de disposer de son argent librement via l’impôt, confiscatoire à partir d’un certain niveau de revenus… Comme cela se traduit logiquement, chez les individus ou les entreprises, atteints dans leurs libertés, par des tentatives de contourner les entraves, et cela produit automatiquement, en réaction, une augmentation de la surveillance, du contrôle, du fichage, de la « transparence » (qui, sur le plan financier ou privé, s’apparente à une volonté de mainmise absolue sur les individus).
En outre, l’égalitarisme d’extrême-gauche qui, on l’a vu, gagne aujourd’hui la gauche classique, conduit à limiter les libertés individuelles de multiples manières, la divergence d’opinion, la volonté de différenciation, étant considérées comme autant de coups de canif intolérables dans une société homogène où tous les hommes ont les mêmes droits mais aussi les mêmes besoins, et dont on attend d’eux qu’ils aient les mêmes comportements. L’État, sur les injonctions d’une gauche victimaire et stigmatisante, devient alors intrusif, restreint les libertés d’agir, de dire, de penser, et bientôt de croire (grâce aux procès d’intention) librement. Dans ce genre de société, au lieu d’éduquer (à penser autrement, à respecter, à rire de choses convenables, à ne pas utiliser de mots blessants, à ne pas blasphémer ni choquer…), on interdit et l’on sanctionne. Parce que certains dérapent (fumeurs, chiens sur les plages, enfants bruyants dans les hôtels), on interdit à tous. Certains intellectuels jugés mal-pensants sont mis à l’index, on appelle à leur boycott, voire leur interdiction (E. Zemmour, A. Finkielkraut…). On ne cherche pas à agir sur la cause, on gomme le symptôme. Une fois encore, la gauche préfère casser le thermomètre par l’interdiction ou la menace que de tenter de le comprendre, voire de le traiter.
Est-on libre de rire de tout ? Assurément non et nombre de comiques, qui n’auraient pas choqué il y a encore une vingtaine d’années, sont aujourd’hui ostracisés, voire condamnés ? La liberté pédagogique n’existe plus, nombre d’enseignants sont sanctionnés, voire mis à pied par des inspecteurs défenseurs de la bien-pensance, pour pédagogies rétrogrades. Sur les réseaux sociaux, il est extrêmement significatif que la quasi-totalité de ceux qui appellent à exclure un contradicteur, qui le bloquent, criminalisent la pensée d’autrui parce qu’elle diverge de la norme autoproclamée par le gauchisme culturel, se réclament, en grands défenseurs des libertés, d’une gauche généreuse et altruiste … sauf pour leurs adversaires. Le terrorisme intellectuel de la Bien-pensance musèle bien plus efficacement que la véritable censure. Vraie censure à laquelle une certaine gauche n’est, d’ailleurs, nullement hostile : la loi contre les fake news, au lieu d’éduquer les individus à les repérer, risque d’interdire beaucoup et à tort pour bloquer quelques informations effectivement erronées; la loi contre la haine sur Internet (ce avec quoi chacun ne peut qu’être d’accord) permet de confondre la haine véritable et la simple expression d’un désaccord (qu’appellera-t-on par exemple islamophobie ? L’expression d’un rejet de la charia islamiste ou un véritable appel à la haine de tout musulman ?). Comme on peut le voir dans les deux derniers exemples, pour interdire et sanctionner, ce gauchisme culturel accumule les lois, l’encadrement, la surveillance.
On touche là à une autre différence entre la gauche et la droite, la gauche infantilise, la droite responsabilise et compte sur l’éducation (comme la gauche d’antan), seule à même de développer un civisme véritable, de former des esprits libres et critiques, pour changer les comportements. Mais cela induit une autre différence, qui peut être perçue comme un apparent paradoxe, la droite, en présence de comportements déviants, en l’absence d’une responsabilisation des individus et lorsque ceux-ci attentent aux libertés individuelles, n’exclut pas des mesures sécuritaires pour protéger les libertés. Pour une certaine gauche, au contraire, la mise en œuvre de l’autorité de l’État à des fins sécuritaires (protéger les individus mais également la propriété individuelle et le bien commun) est liberticide. C’est que la droite fait intervenir la réaction sécuritaire a posteriori , quand le comportement déviant, incivique ou dangereux a été constaté. La gauche a l’inverse procède par procès d’intention et présomption de culpabilité : alors on interdit où l’on tente d’empêcher a priori, une pièce d’Eschyle ou une conférence d’A. Finkielkraut.
Parce que la liberté dite positive, qui est le faux-nez de l’égalitarisme, est «économiquement et même socialement contre-productive, a contrario de la liberté réelle .
Pour la droite, si l’on augmente la pression fiscale jusqu’à ce qu’elle devienne confiscatoire ou qu’elle décourage de travailler davantage, si l’on crée des milliers d’emplois inutiles dans la fonction publique (pour donner artificiellement un revenu donc la capacité de), si on nationalise et ne laisse plus l’émulation de la concurrence opérer pour faire baisser les prix, si on décourage la création et l’investissement par trop de contrôles et réglementations « liberticides », ce sont les mécanismes réels de création de la richesse qui se trouve bloqués. S’il n’y a plus de richesses à partager, c’est un appauvrissement général. Le discours de la gauche, généreux, en faveur des libertés sociales, se trouve arrêté dans sa réalisation puisqu’il y a, d’année en année, de moins en moins à redistribuer à de plus en plus de monde. Si l’on gagne autant sans travailler que les travailleurs aux revenus moyens, ou à peine moins mais avec la tranquillité en plus, tout en se trouvant éligible à des aides innombrables, ce n’est pas un encouragement à l’effort. Pire, on pousse nombre de travailleurs à quitter la vie active et l’on n’incite pas ceux qui, inactifs, bénéficient déjà des aides sociales, à retravailler. Le résultat est que cette générosité aveugle (avec l’argent de ceux qui travaillent dur ) annihile les possibilités de promotion de ceux qui font partie des couches sociales de faible revenu qu’elle n’incite pas à reprendre une activité et, s’ils en ont une, à gagner davantage.
Cette omniprésence de l’État pose problème. Pour le libéral, donc l’individu qui se prétend plutôt de droite, l’État est nécessaire, il est là pour organiser prendre en charge ce que les individus ne peuvent gérer par eux-mêmes (c’est le cas notamment de la sécurité via les forces de l’ordre, armée et police). Mais seulement ça ! Tout ce qui relève de l’individu, de sa responsabilité, doit lui être laissé afin qu’il gère librement sa vie, ses croyances, ses comportements, toujours dans la limite de ne pas empiéter sur la liberté d’autrui.
Pour la gauche française actuelle , profondément marquée par les idéologies collectivistes du XXe siècle [2] , l’État est là au contraire pour régler tous les problèmes des gens à leur place : pour elle, l’individu, surtout s’il est « possédant », est égoïste et ne pratiquera pas la solidarité de lui-même [3] , il s’agit donc de l’y obliger par une intrusion dans tous les secteurs de sa vie professionnelle et privée (culpabilisation, incitations). Mais même en supposant la mise en place un système entièrement étatisé, qui décidera de l’économie ? Au nom de quoi ? Il y aura nécessairement, comme dans les régimes totalitaires de gauche du XXe siècle, la constitution d’une nouvelle oligarchie dirigeante. On a vu trop souvent l’appareil d’État utilisé par des individus ou des entreprises privées comme un moyen de capter l’argent public au détriment de l’intérêt général. Mais pour la gauche, pour augmenter les libertés positives (la possibilité pour tous de faire), l’État a pour fonction également de réguler le libéralisme, de jouer un rôle d’arbitre entre les partenaires sociaux. C’est ainsi que l’État-providence et interventionniste est devenu pléthorique, un État omnipotent qui ne peut agir que par l’augmentation de la pression fiscale, déresponsabilisant l’individu, l’infantilisant, le maternant, suppléant ses manquements. Des parents sont défaillants ? Peu importe, au lieu de tenter de les responsabiliser, de les avertir, on va offrir le petit-déjeuner à l’école. On se démène sur tous les médias pour nous dire de manger cinq fruits et légumes par jour, de ne pas fumer, de boire quand il fait très chaud, de protéger ses rapports sexuels. Et on a raison de le faire car la situation d’assistanat (conséquence de cette omniprésence de l’État et de la déresponsabilisation des individus ) est telle aujourd’hui qu’en cas de problème, nombreux seraient ceux qui reprocheraient au gouvernement d’avoir manqué à ses obligations et à son devoir d’avertissement.
La conséquence est que d’un côté on ne cesse de demander « des aides », que l’on voudrait et imagine automatiques, au lieu de tenter de s’en sortir, que l’on n’abandonne pas la « logique de guichet » attendant tout (un emploi, de l’argent) d’un État, incarné par les gouvernements successifs, et l’accusant de tous les maux lorsque l’on n’obtient pas ce que l’on veut, alors même qu’une partie de ses prérogatives sont passées depuis longtemps aux collectivités locales. De l’autre, on voit augmenter l’irresponsabilité des citoyens, leur manque de culture politique, économique géopolitique (après tout, à quoi bon se former si l’État prend tout en charge?), ainsi que l’assistanat et les difficultés d’un État paupérisé, non en soi mais par l’augmentation exponentielle des demandes
Parce que la liberté négative permet l’éclosion des meilleurs, pas l’égalitarisme.
Toute économie, toute société, a besoin de talents, d’innovations, de capitaines d’industrie, d’individus capables de prendre des risques, d’imaginer autre chose, pour lui ou pour les autres, que ce qu’il a sous les yeux, de trouver des solutions à des problèmes sociétaux… Mais hélas la France, disait Cocteau, « a toujours cru que l’égalité consistait à couper tout ce qui dépasse ». Et c’est bien ce qu’il se passe avec la liberté positive, donc l’égalitarisme, qui limite les libertés de faire dans l’espoir de créer une société idéalement homogène où tout le monde aurait les mêmes besoins donc posséderait la même chose.
Malheureusement, dans les faits, cet idéal se heurte au désir de la majorité des individus de se différencier. On a pu le voir notamment dans l’échec des grands ensembles où l’on avait mis dans le même immeuble, voire sur le même palier, des individus de statuts très différents (ouvriers spécialisés, ouvriers qualifiés, contremaîtres, petits patrons). Très vite le souci de hiérarchisation a repris le dessus, les conflits de voisinage et la volonté de différenciation ce sont multipliés et dès l’industrialisations du pavillonnaire et l’accession au crédit immobilier, tous ceux qui le pouvaient sont allés vers l’habitat individuel, les grands ensembles ne gardant plus, captifs, que ceux qui n’avaient pas le choix. La gauche d’aujourd’hui, du moins en France, étant totalitaire, est liberticide de nature. Elle dit l'être pour de bonnes raisons, puisqu’elle prétend faire le bonheur des gens malgré eux. Mais comme on le voit dans l’exemple ci-dessus, la restriction des libertés, dont celle de se différencier d’autrui, peut provoquer des réactions, jusqu’à devenir totalement contre-productive.
De plus, cette propension de la gauche à tout uniformiser, à nier à l’individu la possibilité de différenciation (par exemple choisir un autre type d’école, d’enseignement, correspondant davantage à ses valeurs ou à ses croyances) empêche l’éclosion des meilleurs et conduit rapidement à la médiocratie. Car en limitant les possibilités, en coupant, rabotant « tout ce qui dépasse » au nom de l’égalité, en interdisant, en taxant, en augmentant la surveillance bureaucratique, en réprimant les initiatives qui n’entrent pas dans la norme, on ne tire pas vers le haut, on aligne sur le plus petit dénominateur commun.
Parce que la liberté négative, a contrario de la liberté positive, est à la base de la démocratie
Il est indéniable que, sur la question des libertés, un des points forts de la droite est sa contribution à l’idée de démocratie alors que la gauche traîne, dans les mémoires collectives, le poids des totalitarismes collectivistes du XXe siècle. La Magna Carta dans l’Angleterre du XIIIe siècle est l’œuvre d’aristocrates. Toutes les chartes de droits et libertés qui garantissent l’individu dans son autonomie personnelle et dans sa dignité relèvent de penseurs dits libéraux et ne font pas partie de l’acquis historique de la gauche. Ce furent encore des gouvernements de la droite libérale qui élargirent le suffrage pour le rendre véritablement universel. C’est encore la pensée de droite qui imagina le principe de la division des pouvoirs se surveillant et se modérant les uns les autres. Et c’est surtout la droite qui aujourd’hui encore défend la démocratie élective, pour mettre tout gouvernement à l’abri de la violence populaire et/ou de la tyrannie d’un seul ou des masses. Autant dire que la « dictature du prolétariat » n’est pas une valeur de droite. Au sens commun, c’est-à-dire l’opinion de la masse, la droite privilégiera toujours le bon sens, celui qui est construit par le recul critique, la connaissance, le refus du manichéisme et qui, de fait, est souvent exprimé par des « élites ». Ce sont ces élites, ces individus payés par des indemnités pour travailler, s’informer et décider à la place des autres qui, dans une démocratie qui fonctionne, représentent le peuple et agissent dans l’intérêt collectif. De nos jours il est indéniable que la démocratie représentative a connu de nombreux ratés, ce n’est pas pour autant que la droite prétend la remplacer par une démocratie directe, comme le RIC réclamé par les Gilets Jaunes. Encore une fois, à droite, on ne jette pas le thermomètre, on tente de guérir les maux .
En définitive, la droite admet de bon cœur que la liberté doive être réglementée et délimitée , pour que nous soyons tous libres dans la légalité et que l’on puisse réduire les inégalités, mais sans tomber dans un égalitarisme niveleur. Pour elle l’égalité est subordonnée à la liberté. C’est absolument l’inverse de la pensée de gauche.
Alors bien évidemment, ce qui précède ne s’en est tenu qu’aux principes généraux , ceux qui sont habituellement reconnus comme caractéristiques de la droite et de la gauche par la science politique. Dans les faits, l’échiquier politique est aujourd’hui beaucoup plus confus, situation qui ne date pas d’hier et que, dès les années 1990, on qualifiait de « brouillard des idées » : certaines personnes qui se réclament de la droite sont égalitaristes et étatistes, comme il y a à gauche des personnes hostiles à l’omnipotence de l’État et très attachées aux libertés négatives, qu’elles font passer avant la recherche de l’égalité. En soi, ce sont des valeurs qui ne sont ni de droite ni de gauche et qui peuvent être défendues par tous. Et tout le monde se dit “social”. L’important est de savoir ce que l’on veut et de déceler qui, ici et maintenant, défend le mieux les valeurs que l’on juge prioritaires.
Pour ma conception de la liberté, que je place au-dessus de toutes les autres valeurs, c’est assurément à droite que je me retrouve le mieux, ou le moins mal.
*
[1] Voir notamment travaux de Isaiah Berlin.
[2] Rappelons qu'au XIXe siècle les socialistes étaient partisans de cette même liberté négative au nom de la résistance à la toute-puissance de l’État et de la religion, jusqu’à ce que le collectivisme (théorisé au XXe siècle, léninisme, stalinisme, castrisme, maoïsme…) vienne remplacer le libéralisme socialiste.
[3] Ce que démentent les sociétés étatsunienne et anglaise, où l'individu est davantage maître de l'utilisation de ses revenus, qu'il utilise largement dans des actions de solidarité et de charité. La différence c’est qu’il décide librement vers qui orienter cette solidarité. Et que les destinataires potentiels font tout pour s’en rendre digne et attirer l’attention par leurs efforts ou leur attitude. De la même façon, au XIXe siècle, sans remettre en cause le rôle que jouèrent partis et syndicats de gauche dans l’obtention des “acquis sociaux”, un grand nombre d’avancées concrètes, réelles, améliorant la vie de l’ouvrier (cités-jardins, crèches, augmentations salariales …), sont le fait de grands capitaines d’industries pétris de “catholicisme social” et qui ont mis en place ces actions généreuses et solidaires librement, sans incitation et encore moins obligation de la part de l’Etat. Cette partie du patronat avait en outre compris que l’amélioration des conditions salariales et de vie est un gage d’efficacité, tant il est évident qu’un individu heureux, motivé, respecté et reconnaissant, travaille avec davantage d’ardeur. Alors que l’exploitation, à termes, devient contre-productive en termes économiques.